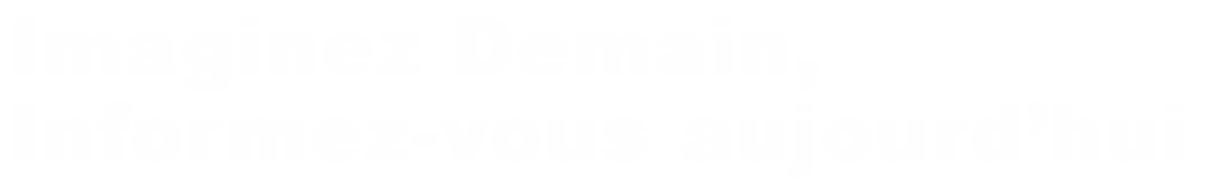Florent Kadri, collaborateur du cabinet-conseil InterGlobe Conseils, livre son analyse dans cet entretien pour Imagine Demain.
Quel impact le démantèlement de l’USAID aura-t-il sur les programmes de développement durable sur le continent africain, et comment les pays concernés peuvent-ils y faire face ?
« Ils laissent un trou béant », déclarait Joël Wengamulay, directeur de la coopération internationale de l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), le 22 mai 2025, en réaction aux conséquences du démantèlement de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), acté par l’administration Trump le 3 février dernier. Cette décision marque une rupture historique aux effets potentiellement dévastateurs pour le continent africain. Fondée en 1961 par le président John F. Kennedy, l’USAID constituait depuis plus de soixante ans l’un des piliers du développement durable dans les pays du Sud, notamment en Afrique. Sa disparition brutale laisse un vide structurel qu’aucun acteur multilatéral ne semble aujourd’hui en mesure de combler pleinement.
Le premier choc est d’ordre budgétaire. Dotée d’un budget de 40 milliards de dollars en 2024, l’USAID figurait parmi les principaux bailleurs mondiaux d’aide publique au développement. Rien qu’en Afrique, des pays tels que la République démocratique du Congo (1,34 milliard de dollars), l’Éthiopie (1,2 milliard), le Nigeria (762 millions) ou le Mozambique (586 millions) bénéficiaient de financements déterminants pour le fonctionnement de services essentiels : santé, accès à l’eau, sécurité alimentaire, éducation, ou encore infrastructures de base. La suppression soudaine de cette enveloppe, estimée à hauteur de 90 %, compromet directement la pérennité de milliers de projets de terrain, avec des répercussions humaines immédiates et durables.
Parmi ces répercussions, la crise sanitaire s’annonce particulièrement alarmante. L’USAID avait, notamment à travers le programme PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief) lancé en 2003, joué un rôle central dans la lutte contre les pandémies sur le continent. Ce seul programme est crédité de 26 millions de vies sauvées depuis sa création. Pour la seule année 2024, l’USAID a permis d’éviter 1,65 million de décès liés au VIH/SIDA, 500 000 grâce aux campagnes de vaccination, et 300 000 dus à la tuberculose. L’arrêt brutal de ces interventions pourrait provoquer une recrudescence de ces maladies, en particulier dans les zones rurales où l’accès aux soins dépendait quasi exclusivement de cette aide. Une étude relayée par Reuters estime à 14 millions le nombre de décès supplémentaires d’ici 2030 si les programmes interrompus ne sont pas rétablis, dont plus de 4,5 millions d’enfants de moins de cinq ans. Face à ce scénario, les systèmes de santé déjà fragiles de nombreux États africains risquent l’effondrement.
Mais les effets du retrait américain dépassent largement le seul champ sanitaire. Dans la province mozambicaine du Cabo Delgado, meurtrie par huit années de conflit armé, l’arrêt des interventions de l’USAID a privé plus de 17 000 personnes d’aide alimentaire, de kits d’hygiène, de semences agricoles et d’un accès à l’eau potable. Ce retrait compromet gravement la résilience des populations, les exposant davantage aux effets combinés de la violence, du dérèglement climatique et des déplacements forcés. Comme l’a rappelé Wengamulay, les programmes de l’agence constituaient un filet de sécurité vital, souvent la seule réponse humanitaire et structurelle dans des contextes abandonnés par les pouvoirs publics.
Ce vide laissé par l’USAID risque, par ailleurs, d’engendrer une instabilité accrue dans des régions déjà fragiles. Privées de soutien économique, social et institutionnel, certaines zones pourraient devenir des foyers d’expansion pour des groupes armés ou extrémistes, en particulier là où l’État central peine à maintenir son autorité. Le développement durable, tel que défini par les Nations unies, repose sur un triptyque fondamental : la paix, la justice et des institutions solides. En supprimant l’un des principaux leviers de coopération internationale, les États-Unis créent une brèche profonde dans cet équilibre, au détriment des perspectives de stabilité régionale.

Dès lors, face à cette situation critique, les pays africains ne peuvent se contenter d’un constat d’impuissance. Une réponse structurée, ambitieuse et concertée s’impose. Il convient d’abord de repenser les partenariats stratégiques. L’Union européenne, les agences spécialisées des Nations unies, les fondations philanthropiques internationales – telles que celles de Bill et Melinda Gates ou du Wellcome Trust – mais aussi les puissances émergentes du Sud global (Chine, Inde, Turquie) peuvent contribuer à amortir partiellement le choc. Parallèlement, la coopération intra-africaine, encore trop marginale, doit être renforcée. Des structures telles que l’Union africaine ou la CEDEAO peuvent jouer un rôle de catalyseur en mutualisant les ressources, les expertises et les réponses.
Un second levier, indispensable, réside dans la mobilisation des ressources internes. Des pays comme le Ghana ou le Botswana ont amorcé une transition vers une plus grande autonomie en matière de financement du développement : diversification économique, renforcement de la gouvernance locale, réforme de la fiscalité. Investir massivement dans le capital humain – personnel médical, éducatif, administratif – devient un impératif. Les États devront également explorer de nouveaux mécanismes de financement : obligations sociales, fiscalité ciblée ou partenariats public-privé à finalité sociale.
Finalement, la société civile et les ONG locales constituent des relais essentiels. Bien qu’elles ne puissent compenser, à elles seules, le retrait d’un acteur de la taille de l’USAID, elles peuvent jouer un rôle clé dans la continuité des services de base, la veille citoyenne et l’interpellation des pouvoirs publics. Leur capacité à s’adapter aux contextes locaux et à agir au plus près des populations en fait des partenaires précieux dans cette phase de reconfiguration.
En définitive, le démantèlement de l’USAID représente une rupture sans précédent, aux conséquences potentiellement dramatiques pour la santé, la sécurité et le développement en Afrique. Il pourrait néanmoins être l’occasion d’un sursaut collectif, en incitant les États africains à repenser leur modèle de développement, à renforcer leurs institutions et à diversifier leurs alliances. Cette transition ne pourra toutefois réussir que si elle est menée avec lucidité, détermination et solidarité – et surtout, sans qu’elle ne se fasse au prix de millions de vies.
Estimez-vous que l’aide publique au développement soit biaisée par son alignement ou non sur les priorités nationales ? Cette aide est-elle efficace ?
L’aide publique au développement (APD) se veut, dans les discours internationaux, un vecteur de justice globale et de solidarité envers les pays les plus vulnérables. Mais dans les faits, elle reste largement conditionnée par les intérêts géopolitiques des pays donateurs, souvent au détriment des priorités nationales des pays bénéficiaires. Ce désalignement nuit profondément à son efficacité, en particulier lorsqu’il renforce des mécanismes de dépendance ou de rente au lieu de soutenir l’autonomisation des économies locales.
Une des limites majeures de l’APD actuelle réside dans sa logique descendante : ce sont souvent les bailleurs qui déterminent les domaines d’intervention, les objectifs, voire les modalités de mise en œuvre des projets. Cela conduit à des actions techniquement réussies mais structurellement fragiles. L’évaluation des programmes d’aide en Zambie, par exemple, a montré que si des écoles, des routes ou des réformes administratives ont effectivement vu le jour grâce à l’APD, les résultats attendus en matière de réduction de la pauvreté ou d’amélioration de la qualité des services publics sont restés très en deçà des promesses initiales (Beuran, Raballand&Revilla, 2011). Ce constat met en évidence une efficacité de court terme (livrables visibles) mais une faible transformation systémique.
Ce biais dans l’approche est aggravé lorsque l’aide contribue, de manière directe ou indirecte, à consolider des régimes autocratiques. En finançant sans conditionnalité des États où les contre-pouvoirs sont faibles, où la redevabilité est minimale, l’APD peut devenir un outil de stabilisation du pouvoir plutôt qu’un moteur de développement. Elle crée des incitations perverses, maintenant des gouvernants en place sans les pousser à engager les réformes nécessaires. Cette réalité est bien décrite par les politologues Bueno de Mesquita et Smith (2012), qui soulignent que l’aide, en étant canalisée selon les intérêts des donateurs, « sert à enrichir les électeurs des pays riches » tout en figeant les rapports de pouvoir dans les pays bénéficiaires. En cela, elle peut faire plus de mal que de bien, car elle décourage le changement et l’innovation politique.
Un autre effet pervers tient à la manière dont l’APD peut alimenter une économie de la rente. Lorsqu’un pays dépend massivement de l’aide pour financer ses budgets publics, il n’a plus intérêt à développer une base fiscale solide, ni à favoriser l’investissement productif. Cette dépendance étouffe l’initiative privée et déresponsabilise les gouvernements. L’économiste DambisaMoyo (2009) illustre cette idée en montrant que les pays qui ont connu un développement rapide ces dernières décennies – en Asie notamment – l’ont fait en misant sur leur capacité interne à créer de la richesse, non en s’appuyant sur une aide extérieure chronique. Elle affirme que l’aide perpétuelle affaiblit les institutions, entretient la corruption et retarde les dynamiques de croissance endogène.
Cela ne signifie pas que toute aide est inefficace. Bien au contraire : quand elle est alignée sur les besoins exprimés localement, pensée en partenariat et inscrite dans la durée, l’aide peut produire des effets majeurs. En Ethiopie, l’APD a pu produire des résultats remarquables lorsqu’elle s’est inscrite dans une logique de partenariat et de renforcement institutionnel. Prenons l’exemple du Health Extension Programme (HEP), porté par l’État éthiopien avec l’appui de bailleurs comme l’USAID, le Royaume‑Uni ou la Banque mondiale. Ainsi, entre 2005 et 2011, ce programme a conduit à un recul de 30 % de la mortalité infantile, de 23 % de la mortalité néonatale et de 28 % de la mortalité avant cinq ans ; la couverture vaccinale a notamment progressé grâce à l’investissement dans la formation de 30 000 agents de santé communautaires. Néanmoins, le gel de l’aide américaine en début 2025 a paralysé les services vitaux en Ethiopie. Plus de 16 millions de personnes dépendaient des livraisons alimentaires financées par l’USAID via le PAM. Ces rations sont restées bloquées à Djibouti, menaçant de pourrir, tandis que les programmes de lutte contre le paludisme, la rougeole ou les soins prénataux ont été interrompus
En résumé, l’alignement de l’aide sur les priorités nationales est un critère décisif pour son efficacité réelle. Lorsqu’elle ignore ces priorités, elle risque de nourrir la dépendance et de légitimer des structures de pouvoir inefficaces. Lorsqu’elle les respecte et les renforce, elle peut contribuer au développement durable et à l’autonomisation des pays concernés. L’enjeu est donc moins de savoir s’il faut plus ou moins d’aide, mais de réinventer le cadre politique, institutionnel et moral dans lequel cette aide est donnée et reçue.
Déjà, l’objectif fixé en octobre 1970 de porter l’aide publique au développement à 0,7 % du revenu national des pays donateurs n’a jamais été atteint. Aujourd’hui, on observe de plus en plus une frilosité croissante des partenaires occidentaux. Quelles sont les raisons qui expliquent cette situation ?
La promesse formulée en 1970 par les Nations unies d’allouer 0,7 % du revenu national brut (RNB) des pays riches à l’aide publique au développement (APD) reste, plus de cinquante ans plus tard, une ambition inachevée. Malgré quelques exceptions notables — notamment les pays scandinaves comme la Norvège, la Suède ou le Danemark — la majorité des États donateurs de l’OCDE ne s’approche guère de ce seuil symbolique. En 2023, la moyenne des pays du Comité d’aide au développement (CAD) s’élevait à seulement 0,37 % du RNB, confirmant une tendance à la stagnation, voire à la régression dans certains cas (OCDE, 2024). Ce recul progressif s’inscrit dans une série de transformations économiques, politiques et géopolitiques qui expliquent la frilosité croissante des pays occidentaux à l’égard de l’APD.
La première cause de ce désengagement tient à des contraintes budgétaires nationales de plus en plus pressantes. Les économies occidentales, ébranlées par les conséquences de la pandémie de COVID-19, les tensions géopolitiques (comme la guerre en Ukraine) et l’inflation persistante, voient leurs finances publiques se tendre. Ces chocs successifs ont intensifié les arbitrages budgétaires et poussé les gouvernements à prioriser les politiques intérieures – qu’il s’agisse de santé, de protection sociale ou de transition énergétique. En Allemagne, par exemple, les débats sur le « frein à l’endettement » ont conduit à des coupes significatives dans les budgets de coopération internationale pour 2024, réduisant les fonds disponibles pour les programmes de développement (Tagesschau, 2024). Dans un tel contexte, l’aide internationale apparaît souvent comme une variable d’ajustement budgétaire.
À cette pression économique s’ajoute un scepticisme croissant à l’égard de l’efficacité de l’aide. Ce diagnostic est corroboré par le cas de la République démocratique du Congo, qui, bien qu’ayant reçu 943millions de dollars d’APD américaine en 2024 (ForeignAssistance.gov, 2024), demeure confrontée à une pauvreté structurelle, une instabilité politique chronique et une corruption endémique. Le décalage entre les sommes engagées et les résultats obtenus alimente une désillusion dans les pays donateurs, justifiant une réduction progressive de leur engagement.
La montée des logiques géopolitiques constitue une autre explication majeure. Alors que la coopération internationale était, dans les années 1990 et 2000, portée par un certain idéalisme post-guerre froide, elle est aujourd’hui soumise à une recomposition stratégique. Les rivalités entre grandes puissances, notamment entre l’Occident et la Chine, transforment la nature de l’aide. La Chine, à travers l’Initiative des Nouvelles Routes de la Soie, investit massivement dans les infrastructures africaines sans exiger de conditionnalités démocratiques, concurrençant ainsi l’APD occidentale traditionnelle (Alden, 2024). Cette nouvelle donne fragilise la légitimité politique de l’aide occidentale et pousse les bailleurs à adopter une posture plus défensive, moins portée sur le long terme et davantage tournée vers des intérêts immédiats : sécurité migratoire, lutte contre le terrorisme ou protection des chaînes d’approvisionnement.
Enfin, la montée du nationalisme et du populisme dans plusieurs démocraties occidentales contribue à ce repli. En valorisant un discours du « chacun pour soi » et une défiance envers les institutions internationales, ces courants politiques plaident pour un recentrage sur les priorités domestiques. Aux États-Unis, l’administration Trump avait engagé dès 2017 une réduction significative des budgets de l’USAID, une tendance poursuivie dans les années suivantes malgré des oppositions internes (CGDev, 2024). Au Royaume-Uni, le gouvernement a décidé en 2021 de faire passer son aide au développement de 0,7 % à 0,5 % du RNB, une baisse justifiée par les impacts économiques de la pandémie, mais saluée par certains segments de l’opinion comme un retour au bon sens budgétaire. Ces décisions politiques illustrent une dynamique de désengagement portée par des considérations électorales et idéologiques.
Ainsi, la frilosité croissante des partenaires occidentaux envers l’APD s’ancre dans un faisceau de causes interdépendantes : contraintes économiques internes, doutes sur l’impact réel de l’aide, mutations de l’ordre international, et repli nationaliste. Loin d’être conjoncturelle, cette évolution reflète une crise plus profonde de la solidarité internationale et pose la question de la redéfinition des finalités, des modalités et des instruments de la coopération au développement dans un monde multipolaire et instable.
Comment l’Afrique peut-elle réussir à financer durablement son propre développement et réduire sa dépendance à l’aide extérieure ?
La capacité de l’Afrique à financer durablement son propre développement sans dépendre excessivement de l’aide extérieure constitue l’un des enjeux majeurs du XXIe siècle pour le continent. Sortir du cycle de la dépendance n’implique pas un rejet de toute coopération internationale, mais suppose une refondation des modèles économiques, fiscaux et institutionnels permettant de bâtir une souveraineté financière réelle. À l’heure où les promesses d’aide peinent à se concrétiser et où les priorités géopolitiques des pays donateurs se déplacent, cette quête d’autonomie devient non seulement souhaitable, mais nécessaire.
La première clé réside dans l’élargissement de l’assiette fiscale et la réforme des systèmes fiscaux nationaux. La mobilisation des ressources domestiques reste insuffisante. Cette faiblesse résulte d’une fiscalité souvent régressive, d’une forte informalité de l’économie, mais aussi d’une incapacité à taxer les multinationales opérant sur le continent. La lutte contre l’évasion fiscale et l’érosion de la base imposable constitue donc une priorité absolue. D’après l’Union africaine, le continent, au cours des cinquante dernières années,a perdu plus de 1 000 milliards de dollars en flux financiers illicites, soit bien plus que ce qu’il reçoit en APD (UNECA, 2020). Des initiatives comme l’African Tax Administration Forum (ATAF) ou le renforcement des administrations fiscales nationales peuvent progressivement inverser cette tendance, à condition de s’accompagner de volonté politique.
Ensuite, l’Afrique doit davantage compter sur l’épargne et l’investissement internes pour financer son développement. Cela implique le renforcement du secteur financier local, en particulier les banques de développement et les marchés de capitaux régionaux. L’essor de fonds souverains nationaux ou régionaux, la structuration de la finance verte, ainsi que la canalisation de l’épargne informelle vers des circuits productifs sont autant de leviers mobilisables. Des pays comme le Rwanda ou le Maroc ont su mettre en place des stratégies cohérentes pour favoriser l’investissement privé dans des secteurs stratégiques, réduisant ainsi leur exposition à l’aide extérieure. L’industrialisation par les chaînes de valeur régionales, appuyée par la mise en œuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), constitue également un instrument puissant pour stimuler la création de richesse et la rétention de la valeur ajoutée.
Le troisième pilier est politique et institutionnel. Financer son propre développement nécessite un État capable, transparent, et légitime. Or, dans de nombreux pays, la faiblesse des institutions entrave l’efficacité de la dépense publique et alimente la corruption. Pour que les citoyens acceptent de contribuer davantage fiscalement, il faut qu’ils aient confiance dans l’usage des fonds publics. Des réformes de gouvernance, une justice plus indépendante, et une participation accrue des citoyens dans les choix budgétaires sont autant de conditions de cette reconstruction du lien fiscal.
Finalement, la diaspora africaine constitue un acteur stratégique trop souvent sous-estimé. Les transferts de fonds des diasporas africaines ont atteint 100 milliards de dollars en 2022, dépassant largement l’APD vers le continent (Banque mondiale, 2023). Ces flux, s’ils sont mieux canalisés, pourraient soutenir des projets productifs ou des investissements dans les infrastructures locales. Des instruments innovants comme les « diaspora bonds » ou des fonds d’investissement transnationaux, associés à une réduction des frais de transfert, permettraient de transformer ces flux privés en capital de développement durable.
En somme, autonomie financière, capacité fiscale, efficacité institutionnelle, dynamisme entrepreneurial : les ressorts de l’autofinancement du développement africain existent, mais exigent une coordination politique forte et une vision à long terme. Loin de signifier un isolement du continent, cette autonomie accrue ouvrirait la voie à des partenariats fondés sur une plus grande égalité, où l’aide internationale deviendrait un levier parmi d’autres, et non une béquille perpétuelle.

Analyste géopolitique stagiaire
http://www.interglobeconseils.org
Étudiant en troisième année de licence du Programme Grande École de SKEMA business school, Florent vise un double diplôme avec Sciences Po Aix-en-Provence en se spécialisant sur les dynamiques géopolitiques et géoéconomiques de l’Afrique du Nord et Moyen-Orient. Il est actuellement stagiaire au cabinet (Juillet-Août).
InterGlobe Conseils est un cabinet d’expertiseen géopolitique, gouvernance politique et communication stratégique.
Fondé en 2010 par Régis Hounkpè, le cabinet rassemble une équipe d’experts présents en France, en Afrique de l’Ouest et au-delà, engagés aux côtés des décideurs pour décrypter les mutations du continent africain et anticiper les bouleversements globaux.
Le cabinet se donne pour mission de fédérer les acteurs soucieux de l’avenir de l’Afrique et des mutations internationales, en leur fournissant des outils d’analyse, de décision et d’action adaptés aux réalités et enjeux contemporains.